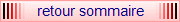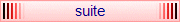Cette ville étendue, vivante, aux vieux bâtiments, s’avère intéressante, avec ses marchés toujours aussi étonnants.
J’y vois l’incroyable travail à la chaine de 2 gamins et leur père pour tuer et déplumer des poulets : un gamin coupe la tête, met le poulet dans une grande boite en polystyrène où ça bouge encore, en reprends un autre inerte, le tend à son frère qui en quelques secondes déplume et tend à son père un truc gros comme un merle, et ainsi de suite. Les poissonniers m’appellent pour se faire prendre en photo. Je fais 16 km sur une route étroite assez secouante, pour rejoindre le village de Nimatighat et la rive du Brahmapoutre d’où partent les ferries pour Majuli, l’île fluviale qui aurait été la plus grande au monde, avant que l’érosion due aux crues du fleuve ne la ramène à 800 km². Le ferry, longue barque de bois, s’apprête justement à partir dans le brouillard et un petit vent frais qu’on doit supporter, debout, à côté des motos et vélos. 2 jeeps sont du voyage. On longe la rive, traverse, et une demi-heure après, le ferry accoste. Quelques baraques à thé et restos rudimentaires sont installés sur la rive. J’emprunte le long chemin de terre,
J’y vois l’incroyable travail à la chaine de 2 gamins et leur père pour tuer et déplumer des poulets : un gamin coupe la tête, met le poulet dans une grande boite en polystyrène où ça bouge encore, en reprends un autre inerte, le tend à son frère qui en quelques secondes déplume et tend à son père un truc gros comme un merle, et ainsi de suite. Les poissonniers m’appellent pour se faire prendre en photo. Je fais 16 km sur une route étroite assez secouante, pour rejoindre le village de Nimatighat et la rive du Brahmapoutre d’où partent les ferries pour Majuli, l’île fluviale qui aurait été la plus grande au monde, avant que l’érosion due aux crues du fleuve ne la ramène à 800 km². Le ferry, longue barque de bois, s’apprête justement à partir dans le brouillard et un petit vent frais qu’on doit supporter, debout, à côté des motos et vélos. 2 jeeps sont du voyage. On longe la rive, traverse, et une demi-heure après, le ferry accoste. Quelques baraques à thé et restos rudimentaires sont installés sur la rive. J’emprunte le long chemin de terre,
sable et paille qui zigzague dans un no man’s land, puis arrive sur une piste surélevée bordée de maisons sur pilotis, avec des gens biens sympathiques, des gamins marrants qui se collent devant l’appareil photo. La piste devient une route étroite, atteint le village de Kamalabari puis la petite ville de Garamur, où je trouve dans un chemin, la Maison d’Ananda, où on me loue pour 150 rp une petite chambre dans un long bâtiment tout en bambou. WC et douche au seau d’eau froide dans une cabane à côté. Les souris s’aventurent jusque dans mes sacs contenant la nourriture. Je passe deux jours à me balader à vélo sur les petites routes tranquilles, au-dessus des champs, marécages, rizières, fréquentés par de nombreux oiseaux migrateurs qui viennent y nidifier : oies sauvages, canards, grues, hérons, aigrettes, cigognes…
Je visite les Sattras, monastères néo-vishnouites, qui se sont affranchis en partie de certains principes de l’hindouisme, comme les castes, les sacrifices d’animaux, l’idolâtrie, abritant des moines danseurs, adepte du Sattriya, style particulier de danse et d’art dramatique. Au retour, après avoir été interviewé par une équipe de tv locale, je dois attendre des heures le ferry, et marchant aux alentours de la rive, je suis accueilli par une famille vivant là pauvrement.
Je visite les Sattras, monastères néo-vishnouites, qui se sont affranchis en partie de certains principes de l’hindouisme, comme les castes, les sacrifices d’animaux, l’idolâtrie, abritant des moines danseurs, adepte du Sattriya, style particulier de danse et d’art dramatique. Au retour, après avoir été interviewé par une équipe de tv locale, je dois attendre des heures le ferry, et marchant aux alentours de la rive, je suis accueilli par une famille vivant là pauvrement.
Je leur montre des photos de famille, de précédents voyages, de ma maison, ça leur plait bien et je leur en offre quelques unes.
Je repars de Jorhat, toujours plein est, par une excellente route et un vent favorable. Je visite un ancien temple à l’entrée de Sibsagar, et m’aperçois au retour que des types essaient à tour de rôle mon vélo chargé que je n’avais pas attaché.
La ville me plait d’emblée, ville historique animée. Trois temples-tours, typiques de l’ancienne dynastie Ahom, aux couleurs rougeoyantes s’élèvent en bordure d’un immense réservoir rectangulaire. Le temple central de 33m de haut est le plus haut temple de l’Inde dédié à Shiva. Des sâdhus assis à l’intérieur accueillent les nombreux pèlerins venus priés et offrir des petites lampes à l’huile de moutarde, dont l’éclairage diffus donne une ambiance particulière au coucher de soleil.
A 4 km de là, Rang Garh, superbe pavillon ovale à deux étages, et l’immense palais Talatalgarh, construits également en briques rouges, témoignent aussi de la grandeur de la dynastie Ahom.
Je repars de Jorhat, toujours plein est, par une excellente route et un vent favorable. Je visite un ancien temple à l’entrée de Sibsagar, et m’aperçois au retour que des types essaient à tour de rôle mon vélo chargé que je n’avais pas attaché.
La ville me plait d’emblée, ville historique animée. Trois temples-tours, typiques de l’ancienne dynastie Ahom, aux couleurs rougeoyantes s’élèvent en bordure d’un immense réservoir rectangulaire. Le temple central de 33m de haut est le plus haut temple de l’Inde dédié à Shiva. Des sâdhus assis à l’intérieur accueillent les nombreux pèlerins venus priés et offrir des petites lampes à l’huile de moutarde, dont l’éclairage diffus donne une ambiance particulière au coucher de soleil.
A 4 km de là, Rang Garh, superbe pavillon ovale à deux étages, et l’immense palais Talatalgarh, construits également en briques rouges, témoignent aussi de la grandeur de la dynastie Ahom.
De nombreuses plantations de thé bordent la route de Dibrugarh. L’Assam fournit 60% du thé indien, d’immenses étendues en sont couvertes dans des zones plates, et si ça n’a pas le cachet des plantations en coteaux de Darjeeling ou Mirik au nord du Bengale Occidentale, ça peut-être beau au lever ou coucher de soleil, envahies par les cueilleurs et surtout cueilleuses, sous les acacias aux troncs blanchis plantés à intervalles réguliers pour faire de l’ombre aux feuilles de thé.